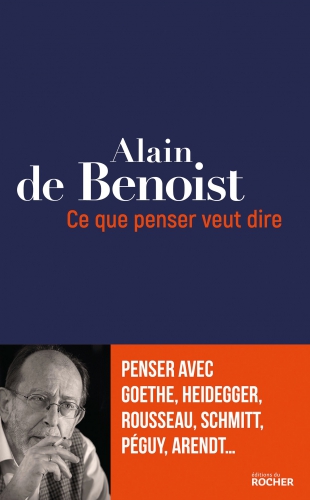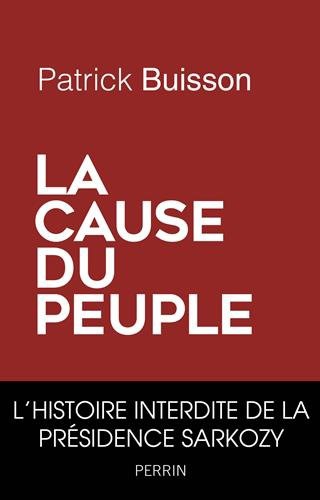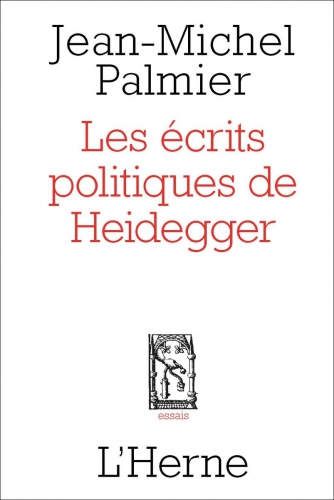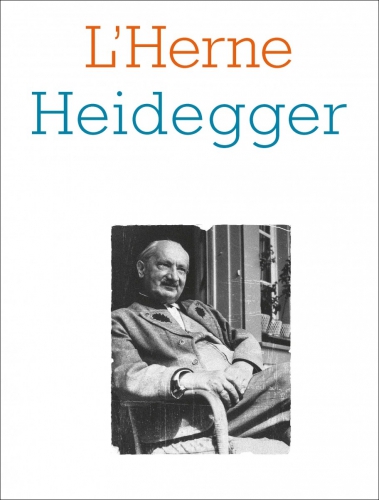• Le samedi 7 mai France Culture recevait des membres de Pièces et Main d'Oeuvre pour une excellente émission sur le Transhumanisme. Contre la modernité technologique ce groupe entend fonder sa révolte en raison et produit une analyse sans concession du progressisme en partant du constat élaboré par Karl Marx suivant lequel la bourgeoisie ne pouvait accroitre ses profits qu'en bouleversant sans cesse les rapports de production et donc les rapports sociaux. Généalogie des travaux de cette équipe depuis le début des années 2000.
• L'historienne Anne Lombard-Jourdan avait publié Aux origines de carnaval; Un dieu gaulois ancêtre des rois de France chez Odile Jacob en 2005. Ci-joint une très bonne critique de son livre.
• Dans "Juvin en liberté" sur TV-Libertés règne incontestablement une impertinence étincelante, loin de tout esprit bravache. Rappelons que cette chaîne qui permet une ouverture sur une réalité que les médias de l'oligarchie nous dissimulent ne vit que des cotisations de ses généreux donateurs.
• Angela Merkel sous influence. Son plan pour l'accueil des "réfugiés" aurait été conçu par une officine de l'OTAN dans laquelle se profile l'ombre de l'inévitable "philanthrope" Soros.
• Le blanc et le noir publie une chronique de Soeren Kern, analyste des politiques européennes. Son thème, l'Europe piégée par Erdogan, président de la Turquie.
• Selon Julien Dir de Breizh infos l'Europe serait prise au piège de son humanitarisme larmoyant dans la crise des migrants. N'osant pas se prononcer franchement contre cet humanitarisme qui fait partie malgré tout de son stock de valeurs, la "majorité silencieuse" qui se tient coite laisse le monopole de la parole aux immigrationnistes qui font passer leurs exigences par le biais de l'humanitaire.
• Julien Rochedy prend ses aises et devient lui-même depuis qu'il a volontairement abandonné ses responsabilités au Front national. Il traite ici de manière facétieuse du paradoxe électoral vis à vis de l'immigration qui veut que les "anti" votent généralement pour des partis assimilationnistes tandis que les "pro" confient leur voix à des mouvements qui ne peuvent qu'aggraver la fracture ethnique du pays.
• Slobodan Despot dans la dernière parution de son bulletin hebdomadaire paraissant le dimanche "parce que le dimanche, on doute" aborde successivement deux auteurs majeurs, Noam Chomsky puis Baudouin de Bodinat dont il a lu la récente publication Au fond de la couche gazeuse qui nous révéle que dans le désastre contemporain la nostalgie serait comme dernier ancrage dans le monde réel, dans le monde d'avant. On peut s'abonner gratuitement à cette publication dont le titre, Antipresse, annonce très exactement le contenu.
• Georges Feltin-Tracol dans son billet montre toutes les apories du Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie (TPIY) à propos du jugement de Vojislav Seselj, sorti libre des prisons occidentales après plus de dix ans d'incarcération à La Haye.
• La réussite de TV Libertés hérisse le poil de l'hebdomadaire Marianne.
• TV Libertés qui, justement, invite Alain de Benoist à s'exprimer sur son dernier livre Au delà des droits de l'homme, pour défendre les libertés. Bel entretien réalisé par Martial Bild.
• Critique du récent livre d'Alain de Benoist Au-delà des droits de l'homme par l'excellente équipe de Philitt.
Le nouveau site de réinformation Paris vox rend compte brièvement de la conférence tenue le 4 mai par Alain de Benoist sur les droits de l'homme. Elle était organisée par le Cercle Kairos.
• Alain de Benoist ne discerne dans Nuit debout ni un ramassis de gauchistes hirsutes et décervelés ni l'esperance révolutionnaire que certains croient y déceler, mais par le "pour-toussisme", le sans-frontiérisme et la-lutte-contre-toutes-les-discriminations qui s'y déploient jusqu'à la nausée, une nouvelle version de ce libéralisme sociétal inapte à contester le Système en place qui se nourrit exactement des mêmes valeurs.
• Alain de Benoist était l'invité le 7 mai du Centro Studi Eurasia-Mediterraneo pour une conférence à propos de la traduction de son livre en langue italienne, Il trattato transatlantico. La manifestation se tenait à Modène avec le soutien de la commune (vidéo).
• Alain de Benoist sur Donald Trump et ce que son succès signifie.
• Pour Michel Geoffroy, l'un des piliers de la Fondation Polémia, pour l'emporter le populisme doit être social et non pas libéral. Proposition qui ralliera les suffrages de tous ceux qui ont apprécié la lecture du dissident Jean-Claude Michéa.
Pour Éric Zemmour le traité de libre-échange transatlantique (TAFTA) est mort-né, c'est du moins ce qu'il avance dans sa chronique sur RTL du 28 avril 2016.
• Nicolas Gauthier sur Boulevard Voltaire persifle la "vraie droite" sorte de dahu du monde politique et approuve la ligne sociale suivie par Marine Le Pen et Forian philippot.
• D'après Claude Sicard l'islam n'est pas soluble dans la civilisation européenne et les Européens en prennent de plus en plus conscience.
• Pour Mathieu Bock-Côté, indépendantiste québécois qui a le sort de la France au coeur, l'esprit multiculturaliste domine l'esprit publique depuis que la gauche est passée du socialisme à l'antiracisme au début des années quatre-vingt et que la droite a déserté toute réflexion. Certes le multiculturalisme est en crise, désavoué par le réel, mais son malaise provoque la radicalisation de ses thuriféraires qui pourraient être tentés par le despotisme pour imposer leur vue.
• Jean-Paul Brighelli propose de licencier les idéologues qui encombrent le ministère de l'Éducation nationale (première référence) et se moque des "pédadémagogues", ces faquins qui appauvrissent le lexique pour rendre la lecture plus agréable aux jeunes esprits (seconde référence).
• François-Xavier Bellamy, auteur d'une belle étude sur le devoir de transmettre commente le changement des manuels scolaires dans le secondaire.
• On sait que pour les néo-républicains l'histoire n'est plus notre code et qu'il est juste de transmettre à nos collégiens un bréviaire du peuple inédit accentuant le dénigrement de soi comme accès à la société diversitaire. Certes, si le "roman national" en usage autrefois véhiculait de nombreuses mythologies, il avait l'avantage de soustraire les jeunes esprits aux interrogations morbides sur leur passé et à exalter un récit propre à la rêverie, préambule souvent à la passion pour la discipline. Cette propédeutique par le légendaire n'excluait nullement que l'on puisse, une fois parvenu à l'âge adulte, rétablir une narration plus conforme à la réalité toujours complexe des choses où il ne s'agit plus d'opposer une magie blanche à une magie noire de l'histoire. Illustration avec Virginie Vota qui ne prend guère de distance avec son sujet.
• Émission de la Vieille Europe dirigée par Patrick Péhèle, sur Radio Courtoisie. Elle se divise en trois parties. La première consiste en un entretien avec Michel Thibault, directeur de la revue Éléments sur le centième anniversaire des Pâques sanglantes. La seconde en une discussion avec Thibault Isabel rédacteur en chef de la revue Krisis sur les caractères psychiques qui semblent dominer la société contemporaine d'Amérique de Nord. La troisième partie permet à Pascal Esseyric, rédacteur en chef d'Éléments, de disserter sur la thèse du berceau unique de l'humanité, doctrine radicalement contestée par des chercheurs essentiellement chinois.
• Éric Zemmour sur Nuit debout en proie à la violence de fait mais à la bienveillance des médias.
• Selon Éric Zemmour le concours de l'Eurovision est une épreuve de dressage au politiquement correct. Avec son humour radical et décalé ne nous dit-il pas ce que nous sommes en train de devenir ?
• Jean Bricmont penseur libertaire et a-dogmatique s'interrogeant sur le mouvement Nuit debout et les propos de Frédéric Lordon qui a justifié l'expulsion d'Alain Finkielkraut par ses organisateurs pose avec perspicacité la question de savoir qui doit être exclu des mouvements qui se veulent "populaires". La propension de ces activistes à molester tout ce qui selon eux relève d'un "fascisme" à l'extension indéfinie serait la marque, selon Bricmont, d'un maccarthisme pathologique contraire à l'esprit d'ouverture dont le mouvement devrait faire preuve si il cherche à briser la quiétude de l'entre-soi.
• Les décodeurs du Monde signalent à juste titre que les citations apocryphes de Bernard Cazeneuve dont une certaine droite se sert pour le dénigrer sont de toute évidence truquées. Effectivement les citations fabriquées ou falsifiées pour les besoins de la cause sont d'un usage idiot quand l'actualité nous fournit chaque jour son lot d'authentiques informations et de propos délétères produits par le ministre. En l'occurrence la mauvaise monnaie de l'information chasse la bonne et permet aux folliculaire des médias appointés de jeter le discrédit sur l'ensemble des sites non alignés.
• Autre falsification qui plaira cette fois à nos "élites" et au médias de grand chemin, celle de cette chercheuse africaine qui entend démontrer que la présence "négro-africaine" précède la présence "blanche" sur le territoire de l'Europe. À chacun ses délires pourrait-on dire, mais celui-là quel que soit le "racisme" qu'il véhicule va incontestablement dans le sens des vents dominants puisque son but affiché est de lutter contre le "racisme scientifique". Il ne faut pas gâcher une aussi noble cause.
• Bernard Lugan revient sur un mythe statistiquement démenti depuis des lustres mais sur lequel les enchanteurs de l'historiquement correct ne se lassent pas de revenir. Non, la France n'a pas gagné la première guerre mondiale grâce à la chair à canon africaine.
• Denis Tillinac a sans doute raison quand il dit qu'il ne saurait y avoir de "valeurs républicaines", mais n'a-t-il pas tort quand il identifie le clivage droite-gauche à une permanence de l'être français présent dans notre identité politique depuis la révolution sinon depuis les guerres de religion ? Il est à craindre que sous prétexte d'envisager à juste titre le temps long de l'histoire Tillinac se retranche uniquement dans un passé fané en se refusant d'analyser ce qui dans la situation d'aujourd'hui permettrait de renouveler des oppositions fondamentales susceptibles de réveiller un peuple français embourbé dans l'anesthésie.
• Dans cet entretien avec Figaro vox Denis Tillinac reproche à la droite d'avoir oublié son imaginaire et de se concentrer sur l'économie et argumente sur la dépression des troupes parce que les chefs sont déficients. Comme d'autres il blâme la droite de s'être abandonnée par paresse au gauchisme culturel, et il le fait avec un talent de plume évident.
• Yannick Jaffré sur les tartufes de l'affaire Denis Baupin met en cause non seulement cet homme sans doute trop romantique mais également son épouse Emmanuelle Cosse. Que ces accusations de harcèlement viennent toutes de membres d'ELV-Les Verts, quelques semaine après que le couple les ait quittés pour partager la gamelle ministérielle ne doit pas être sous-estimé (première référence). Éric Zemmour s'en donne à coeur joie sur cette affaire révélatrice du dire et du faire de certains hommes politiques (seconde référence).
• Dans un billet particulièrement bien enlevé et pénétré de remarques acidulés mais au combien réalistes, le philosophe Yannick Jaffré exécute celui qu'il appelle Aimefric Chauprade. Au bout de ses multiples traitrises celui-ci n'aura même pas mérité son salaire de trente deniers.
• Le même Yannick Jaffré produit une excellente mise au point philosophico-politique malheureusement bien trop longue (plus de quatre heures) selon les règles actuelles de la communication. Pour ceux qui en sont restés à la restitution des idées qu'on ne saurait résumer dans un tweet.
• Luc Rosenzweig de Causeur et ancien journaliste au Monde analyse le cas de Sadiq Khan, nouveau maire de Londres. À la nouvelle de son élection tous les éditocrates de la presse française ont fait chorus pour une standing ovation. Pourquoi ? Parce que il est issu d'une minorité "dominée", pauvre et musulmane. Sans se poser la moindre question sur son programme qui a pourtant rallié une majorité de l'électorat. Comme quoi cette propension des journalistes à juger les individus sur leur seule naissance n'est pas seulement la marque d'un Ancien Régime honni.
• Le prix Charlemagne pour l'unification européenne a été remis au pape François par Jean-Claude Juncker (président de la Commission), Donald Tusk (président du Conseil) et Martin Schulz (président du Parlement européen). Angela Merkel, Matteo Renzi, le roi Felipe d'Espagne ainsi que Marion Draghi assistaient à la cérémonie où Najat Vallaud-Belkacem représentait la France. Comme l'a noté Le Monde l'Europe, divisé, malade, aux abois devant la crise migratoire espère trouver auprès du souverain pontife un peu de soutien moral. Le pape qui exhorte une Europe toujours plus "frileuse" a accueillir toujours plus de migrants a ainsi reçu le salaire de sa défection et de son alignement sur les intérêts de l'oligarchie mondialiste. Et, il ne s'est trouvé personne pour lui remémorer ces paroles de l'évangile de Matthieu (7/15) : "Gardez vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Ces hommes là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtre de Christ... Leur fin sera selon leurs oeuvres".
• Bien que son concert pour les "kouffars" soit annulé à la suite d'une avalanche de protestations, Maxime Tandonnet, haut fonctionnaire chargé des problèmes de l'immigration sous la présidence Sarkozy, dit tout ce qu'il faut penser de l'invitation du rappeur Black M pour clore les cérémonies de la commémoration du centième anniversaire de la bataille de Verdun (première référence). Mieux que cet évènement festif et racailleux bien dans l'esprit des têtes molles de la France légale d'aujourd'hui voici l'allocution prononcée par Ernst Jünger devant les membres de l'association "Ceux de Verdun" le 24 juin 1979, autant dire dans une époque préhistorique. Il s'y exprime avec haute tenue; celle qui fait défaut à nos bouffons prétendument "politiques" (seconde référence). Pour la troisième référence nous avons retenu un texte de Régis de Castelnau, avocat, contre lequel l'argument rituel a fusé : "extrême droite raciste !" Hélas ou tant mieux cet argument n'intimide plus personne et prêterait plutôt à sourire. Qu'auraient dit les apôtres du Bien si l'on avait organisé une techno-parade pour l'anniversaires de la libération du camp d'Auschwitz ? Michel Geoffroy (Polémia) dans son texte un brin polémique va plus loin en pointant une entreprise de subversion généralisée et de déconstruction de l'identité française (quatrième référence). Enfin ce passage en revue se termine avec l'excellente chronique pêchée sur le site d'Idiocratie (cinquième référence).
• Nous donnons la référence du Monde qui le soir du vendredi 13 essaie de tirer la leçon de l'annulation, y voyant une victoire de la "fachosphère" évidemment "raciste" tandis que madame Audrey Azoulay, ministre de la "culture" et de l'entertainment, rabâchant des mêmes incantations magiques croit déceler dans cette déprogrammation le triomphe "d'un ordre moral nauséabond et décomplexé". Quant au secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean Marc Todeschini, il y a saisi gravement "un premier pas vers le fascisme", rien que ça ! Décidément les éléments de langage ne volent pas très haut et ne méritent qu'un grand moment d'hilarité.
• À ce propos rappelons que le site Theatrum Belli a eu la bonne idée de rediffuser l'entretien d'Ernst Jünger avec Philippe Barthelet enregistré sur France Culture en 1993.
• Enfin, nous réparons un oubli avec une émission de Méridien Zéro diffusée en janvier dernier et intitulée Au delà de la Nation : l'Empire. Animée par Pascal Lassalle et Georges Feltin-Tracol, elle recevait Alain de Benoist pour un très riche entretien.